Les Arabes ne sont pas gens de la mer, mais fils du désert. Depuis des siècles, les bédouins ont appris à vivre du chameau et du palmier, à parcourir les étendues désolées de la péninsule arabique, à se rassembler autour des rares points d'eau. Nomades et sédentaires tirent leurs ressources de l'élevage, de l'agriculture, du commerce caravanier, mais ne s'aventurent guère sur l'océan, qui les terrifie, et ils ignorent la navigation, qu'ils laissent à d'autres, venus d'Inde, d'Ethiopie, de Byzance.
A la suite de l'Ancien Testament, le Coran décrit la mer comme l'un des éléments de la création qui témoignent de la puissance de Dieu, mais aussi comme un milieu hostile, où surgissent, de manière imprévisible, tempêtes et ouragans : « Les actions des mécréants sont semblables à des ténèbres sur une mer profonde : des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues sous un épais nuage ; ténèbres entassées les unes au-dessus des autres » (XXIV, 40).
La conquête arabe fut d'abord l'œuvre de cavaliers quittant l'Arabie pour les riches terres du Croissant fertile. Sous la direction de généraux remarquables - Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As -, les Arabes s'emparèrent en quelques années, de 634 à 639, de la Syrie et de la Mésopotamie. Quelles forces, quelles raisons les ont poussés à délaisser leurs oasis et leurs terres pour attaquer les grands empires de l'époque ? La question a souvent été posée, les réponses n'ont pas manqué [1].
Dans l'islam naissant du VIIe siècle, la guerre de conquête est constitutive du message que Dieu envoie aux hommes par l'intermédiaire de son prophète Mahomet : l'unité de la communauté doit se réaliser par le combat contre l'Infidèle et par la soumission à Dieu. Tel est le sens, à la fois religieux et social, politique et militaire, de l'exhortation coranique : « Combattez dans le chemin d'Allah ! » La relative facilité des conquêtes a conforté les Arabes dans l'idée que Dieu avait tenu la promesse faite à son prophète et que l'islam était la vérité. Pour un musulman, le combat dans la voie d'Allah est donc partie intégrante de sa religion ; le succès lui assure la richesse en ce monde, le paradis dans l'autre.
L'Empire perse sassanide tenta de résister, mais s'effondra dès le lendemain de la victoire arabe de Qâdisiyya, pendant l'été 637. L'Empire byzantin, lui, réagit vigoureusement, mais, après la bataille du Yarmûk en août 636, les forces de l'empereur Héraclius durent évacuer la Syrie et se replier au nord du Taurus. L'Egypte, riche province, qui envoyait chaque année des cargaisons de blé à Constantinople, était désormais à la portée des Arabes. Ceux-ci l'attaquèrent par terre : Pélouse et Héliopolis furent enlevées, puis Babylone d'Egypte, à la pointe du delta du Nil, qui capitula au début de 641. Les Arabes fondèrent alors Fustât, ville-camp qui annonce la future métropole du Caire. De là, les conquérants assurèrent progressivement leur domination vers le Sud en remontant le long du fleuve, vers l'Ouest en prenant la belle oasis du Fayyoum, vers le Nord enfin : Alexandrie tomba en 641.
Les communications maritimes n'étant pas coupées, Constantinople envoya des renforts et reprit Alexandrie en 645. Néanmoins, les coptes d'Egypte, monophysites [2], n'étaient pas défavorables au nouvel occupant, qui leur assurait plus de liberté que le pouvoir constantinopolitain, avide d'impôts et défenseur maladroit de l'orthodoxie proclamée au concile de Chalcédoine, en 451. Le général Amr ibn al-As se ressaisit et rejeta les Byzantins à la mer dès 646 : le grand port méditerranéen était définitivement passé aux mains des Arabes. Mais ceux-ci choisirent Fustât comme métropole de la province et Alexandrie connut un déclin certain pendant plusieurs siècles.
Après un temps d'arrêt - dû à la nécessité d'organiser ce nouvel empire et, plus encore, aux dissensions internes qui aboutirent à la grande cassure entre sunnites, chi'ites et kharidjites [3] - l'assaut arabe reprit. Toujours par voie de terre. Et dans deux directions : vers l'Est avec l'Iran, le Khurassan, la Transoxiane. Vers l'Ouest, avec l'Afrique du Nord et l'Espagne. Cairouan fut fondée en 670 pour servir de base à la conquête de l'Occident ; sa position à l'intérieur des terres, loin de Carthage et des côtes, la protégeait des raids maritimes des Byzantins sur le Nord de la Tunisie. Si la progression fut longue et difficile en raison de la forte résistance des Berbères et des Byzantins, en 708 tout le Maghreb était soumis à Mûsâ ibn Nusayr, gouverneur envoyé par Damas.
Un affranchi de Mûsâ, Târiq ibn Ziyâd, conquit Tanger et, au printemps 711, franchit le détroit qui le séparait de l'Espagne : Gibraltar, qui lui doit son nom (Djebel Târiq, la montagne de Târiq). Mais les Arabes, alors contraints de naviguer, ne le firent pas sans réticence si l'on en croit le chroniqueur andalou qui rapporte le dialogue épistolaire engagé entre le gouverneur Mûsâ et le calife al-Wâlid. De Tanger, Mûsâ avait écrit à al-Wâlid pour lui exposer son projet d'envahir la péninsule Ibérique. Il reçut cette réponse : « Envoie quelques détachements pour explorer le pays et te faire un rapport exact. Car tu ne dois pas exposer les musulmans au hasard d'une mer aux vagues démontées. » Ce à quoi Mûsâ rétorqua :« Ce n'est pas une mer, mais un détroit. Celui qui regarde depuis une rive voit les formes de l'autre rive. »
CELUI QUI MEURT SERA RÉCOMPENSÉ
Et l'expédition eut lieu. A la tete d'un fort contingent de Berbères ralliés à l'islam, Târiq, rejoint par Mûsâ, entra à Cordoue puis à Tolède en 711. En quelques années, la plus grande partie de la péninsule fut conquise et l'avance musulmane se poursuivit au nord des Pyrénées : Narbonne fut occupée en 715 et Carcassonne capitula en 725. Mais la victoire de Charles Martel en 732 près de Poitiers annonçait le reflux de la conquête et, à partir du milieu du VIIIe siècle, les troupes musulmanes se cantonnèrent au sud des Pyrénées.
On a dit que les Arabes rêvaient d'atteindre Constantinople par terre, à partir de l'Espagne et de la Gaule, faisant ainsi le tour de la Méditerranée. En fait, les connaissances géographiques des califes et de leurs généraux ne leur permettaient pas d'imaginer une telle stratégie. Mais, avec la conquête de ces espaces nouveaux, les Arabes entrevirent la nécessité de maîtriser la mer. Depuis les reconquêtes de l'empereur Justinien 1er (527-565) sur les envahisseurs barbares en Afrique du Nord, en Italie et en Andalousie, Byzance dominait la Méditerranée. Seule la mer reliait les possessions byzantines, elle était la seule route sûre que Constantinople pouvait emprunter pour contrôler ses provinces lointaines et envoyer des renforts. Une multitude de bateaux de commerce sillonnaient constamment la Méditerranée et le Pont-Euxin (l'actuelle mer Noire), assurant le trafic entre l'Orient et l'Occident.
La flotte byzantine était, au début du VIIe siècle, la seule flotte de haute mer : ses escadres de dromons (navires de guerre mus à la rame), attachées aux grands ports, assuraient partout la sécurité de la navigation. Aussi, pour les Arabes, la grande puissance à abattre une fois le dernier souverain sassanide tué à Marw (dans le Nord-Est iranien) en 651, c'est Byzance. La lutte doit donc être aussi menée sur mer. Or les Arabes n'ont aucun passé maritime ; ils ne savent pas construire de navires, ils ne sont pas capables de se diriger sur la mer, ils ne connaissent pas la technique du combat naval. Certaines traditions, attribuées à Mahomet mais nées dans ce contexte nouveau, témoignent de leur répugnance à se risquer sur les flots, mais aussi de leur volonté nouvelle de poursuivre les conquêtes en Méditerranée. Ainsi, la récompense du martyr est promise à celui qui, en combattant sur mer, est atteint de vomissements ou, a fortiori, périt noyé. Et une campagne sur mer vaut dix campagnes sur terre !
La première flotte arabe fut construite dans le port de Tripoli de Syrie, avec l'aide d'artisans de la région, à l'initiative du gouverneur Mu'awiyya, le futur calife fondateur de la dynastie des Omeyades. « C'était la première fois que les musulmans naviguaient sur la Méditerranée », constate le chroniqueur al-Baladhuri, relatant l'assaut contre Chypre de 648. Les expéditions se multiplièrent alors contre les îles - Chypre, Rhodes, la Crète - et contre les rivages de l'Asie Mineure. Mais ces opérations, qui tenaient plus de la piraterie que de la conquête, ne semblent pas avoir suscité de grandes inquiétudes à Constantinople, où l'on se préoccupait beaucoup plus de l'avancée des Arabes sur terre.
En 655, les Arabes manifestèrent, pour la première fois, leurs capacités dans l'art de la guerre navale en remportant une grande victoire près de Phœnix, au large des côtes méridionales d'Asie Mineure. Dans les arsenaux de Tripoli, d'Alexandrie, de Tunisie, ils construisirent des bateaux à deux files de rameurs, de même type que les dromons byzantins. Charpentiers, menuisiers et calfateurs étaient le plus souvent, tout comme les hommes d'équipage, des coptes. Désormais, des flottilles arabes appareillaient régulièrement d'Egypte, de Syrie, d'Ifrîqiya (Tunisie et Algérie orientale), perturbant l'activité commerciale de Byzance, affectant la prospérité d'un grand nombre de villes côtières, menaçant les populations des îles et du littoral. Mais ces opérations - débarquement rapide et pillage - ne signifiaient pas conquête territoriale et Byzance sut y faire face en réorganisant sa flotte.
Les grandes escadres de dromons furent complétées, dans la seconde moitié du VIIe siècle, par des unités légères capables d'intervenir rapidement contre les pirates arabes. Cette flotte de défense côtière, placée sous la direction du stratège des karabisianoi (« marins »), véritable amiral en chef, assura efficacement la défense de l'ensemble du littoral. Sous l'empereur Léon III (717-741), ce commandement unique fut dissous ; les flottes des différents thèmes (provinces de l'Empire byzantin) furent placées sous l'autorité d'un drongaire et établies dans les régions directement menacées par les Arabes. Ainsi, Byzance sut garder, pour un siècle encore, la maîtrise de la Méditerranée et assurer la sécurité des routes maritimes menant à Constantinople.
A plusieurs reprises, les Arabes ont pourtant tenté d'abattre l'Empire byzantin dans sa capitale même. De 672 à 678, des assauts furent lancés, en vain, chaque été. Puis, en 717-718, la cité subit une double attaque, par mer et par terre, des troupes arabes qui ont franchi le Taurus, traversé l'Anatolie et débarqué sur le détroit du Bosphore. Mais les Byzantins possédaient le secret d'une arme terrible, le feu grégeois, utilisé pour la première fois en 678. Ce mélange de soufre, de salpêtre et d'huile de naphte, qui avait la propriété de brûler sur l'eau, leur permit de repousser les assauts des Arabes sur mer. Aucune armée musulmane ne reviendra sous les murs de Constantinople avant 1453. Cité imprenable, la capitale de l'Empire byzantin prit, aux yeux des Arabes, les dimensions d'un mythe.


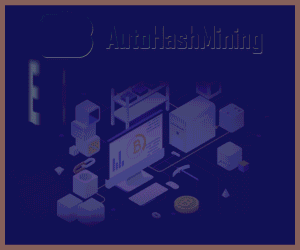


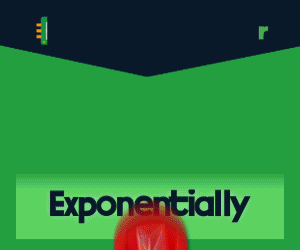











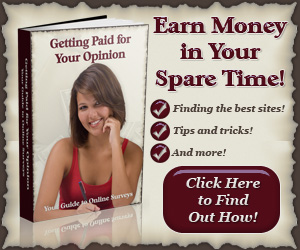


0 Commentaires